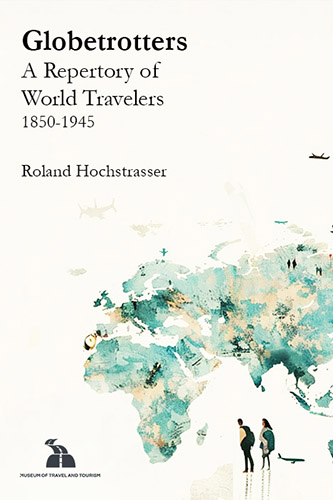Le mystérieux protagoniste se laisse entraîner dans une discussion avec certains membres du club qui, à partir d’événements récents — notamment le vol de 55 000 livres sterling —, débattent de la facilité pour un voleur de disparaître dans un monde de plus en plus petit. Phileas Fogg finit par accepter le pari lancé par M. Stuart et soutenu par ses collègues Fallentin, Sullivan, Flanagan et Ralph. Les gentlemen parient 20 000 livres sur l’impossibilité d’accomplir le tour du monde en 80 jours.
Fogg part de Londres le soir même, pour revenir victorieux 80 jours plus tard, le 21 décembre. Pour réaliser cet exploit, il utilise une grande variété de moyens de transport : paquebots, chemins de fer, voitures, yachts, navires de charge, traîneaux et même éléphants. Chaque étape est ponctuée d’imprévus et d’aventures insolites, souvent compliquées par la ténacité de Fix, l’inspecteur persuadé que Fogg est un voleur de banque, et qui le poursuit dans l’espoir de l’arrêter.
Outre la version écrite, il convient de rappeler l’adaptation théâtrale de l’histoire, réalisée par Verne avec Adolphe d’Ennery. Le 7 novembre 1874, la première de la pièce homonyme est présentée au Théâtre de la Porte-Saint-Martin à Paris, avec un immense succès : elle sera jouée sans interruption jusqu’au 10 novembre 1878.
Dans leur ensemble, le roman et sa version théâtrale ont su inspirer une multitude de générations de voyageurs et ont marqué une rupture par rapport aux dynamiques du passé. Avec la publication du volume de Verne et sa fascinante adaptation scénique, on assiste à un intérêt croissant pour le thème : le tour du monde devient une compétition entre réalité et fiction, à laquelle participent personnages imaginaires, journalistes, auteurs et simples vagabonds.
Le célèbre poète et cinéaste français Jean Cocteau, fasciné par les aventures de Fogg, réalisa son propre tour du monde entre le 28 mars et le 17 juin 1936, écrivant à ce sujet :
« Le chef-d’œuvre de Jules Verne, avec sa couverture rouge et or de livre de prix, la pièce qui en fut tirée, derrière le rideau rouge et or du Châtelet, ont excité notre enfance et nous ont donné, plus encore qu’une mappemonde, l’amour de l’aventure et le désir de voyager. » (Cocteau, Jean. Il mio primo viaggio. DeAgostini, 1964).
Rendus célèbres par le désormais légendaire Phileas Fogg, les globetrotters ont connu un âge d’or durant les premières décennies du XXe siècle, une période marquée par des progrès technologiques rapides et une curiosité croissante pour l’inconnu. Les globetrotters, issus de toutes les couches sociales, se sont lancés vers des horizons inconnus avec enthousiasme et parfois une grande insouciance. Imaginatifs et intrépides, ils ont accompli les expéditions les plus improbables à l’aide de moyens souvent de fortune, contribuant eux-mêmes à la construction d’un nouvel imaginaire mondial et d’une nouvelle manière de concevoir le voyage.
Changements mondiaux et émergence des globetrotters
Dans le contexte historique du XIXe siècle, certaines innovations majeures dans le domaine des transports ont révolutionné les possibilités de voyager à l’échelle mondiale. La première ligne de chemin de fer transcontinentale aux États-Unis, inaugurée en 1869, a permis des liaisons rapides et sûres d’une côte à l’autre. La même année, l’ouverture du canal de Suez a réduit de manière spectaculaire le temps de navigation entre l’Europe et l’Asie, facilitant ainsi le commerce et l’exploration. Parallèlement, l’introduction d’un réseau ferroviaire unifié en Inde a considérablement amélioré la mobilité au sein du sous-continent.
L’invention du moteur à combustion interne a marqué un nouveau pas en avant dans les transports : l’automobile, qui commence à se répandre au début du XXe siècle, rend les voyages terrestres plus rapides et plus abordables. Parmi les exploits notables figure la course automobile Pékin-Paris de 1907, qui a démontré la robustesse et la capacité des véhicules à parcourir de longues distances.
L’aviation a elle aussi apporté une contribution fondamentale à la mobilité. Les premiers vols des frères Wright en 1903 ont ouvert la voie aux trajets aériens longue distance. Au cours des années suivantes, l’aviation a connu des progrès rapides, avec des vols transatlantiques et des tours du monde qui ont rendu la planète encore plus accessible. Le premier tour du monde en avion fut réalisé par une équipe américaine en 1924. L’exploit, bien que plus lent que celui imaginé par Jules Verne, a duré 175 jours et permis de parcourir 42 400 kilomètres, en volant d’est en ouest à travers le Pacifique, l’Asie, l’Europe et l’Atlantique.
C’est dans ce contexte dynamique, marqué par d’énormes transformations technologiques et sociales, que prennent place les aventures des globetrotters — une réalité souvent oubliée ou, au mieux, reléguée aux notes de bas de page des ouvrages consacrés aux principaux phénomènes sociaux et économiques. Pourtant, entre le XIXe et le XXe siècle, des milliers de voyageurs se sont lancés dans les entreprises les plus extravagantes, souvent sans préparation adéquate ni ressources suffisantes. Ces micro-histoires, dans leur diversité, offrent une clé de lecture précieuse du phénomène touristique et des mutations vécues par la société dans son ensemble.
Pendant des décennies, les globetrotters ont été des célébrités éphémères, arrivant à l’improviste dans des villes et villages où ils suscitaient, du moins au début, un certain engouement. Le phénomène se présente sous des formes diverses et ouvre une réflexion sur des questions sociales sensibles. Par exemple, les premiers voyages de femmes aventurières témoignent d’une nouvelle place accordée aux femmes dans la société. De la même manière, les efforts de centaines de voyageurs en situation de handicap soulignent leur volonté d’affirmer leur normalité dans une société qui tend à marginaliser ceux qui ne correspondent pas aux standards établis.
Les aventures documentées à partir de la fin du XIXe siècle sont loin d’être homogènes. Les documents produits par les voyageurs et les témoignages publiés dans la presse relatent des tours du monde, des traversées transcontinentales, des itinéraires variés, réalisés seuls ou en compagnie d’autres personnes — ou même d’animaux — à l’aide de moyens mécaniques comme des bicyclettes, des motos ou des automobiles. Cette diversité se reflète dans les profils mêmes des protagonistes : hommes, femmes, enfants, nourrissons, personnes âgées. Mus par des motivations très diverses, ils ont porté des projets tantôt originaux, tantôt banals, authentiques ou inventés. À cette population bigarrée, il faut ajouter une catégorie souvent oubliée, qui joue pourtant un rôle essentiel dans l’imaginaire collectif : celle des voyageurs imaginaires — des globetrotters nés des récits d’auteurs, qui, à l’image de Jules Verne, ont créé des personnages emblématiques devenus des sources d’inspiration inépuisables.
Les traces fragiles des globetrotters : un répertoire incomplet
Bon nombre des récits présentés dans ce Répertoire restent inachevés et sont difficiles à reconstituer ou à vérifier. Historiquement, le voyage a toujours impliqué un jeu constant de dissimulation de soi — une technique utilisée non seulement pour échapper aux dangers qui guettent le voyageur imprudent. Chaque périple peut comporter une part d’ombre, révélée ou non en pleine conscience :
« Le voyageur peut ainsi s’inventer un passé qu’il n’a jamais eu ; il peut dissimuler son identité réelle de mille façons, la cacher ou la révéler selon les circonstances. Il peut s’efforcer de s’adapter à la réalité qu’il traverse, en changeant de rôle ou de statut, pour des raisons personnelles bien fondées ou simplement dans l’espoir d’en tirer un avantage immédiat et concret »
(Mazzei, 2013).
Les témoignages sont souvent limités, incohérents ou contradictoires, ce qui rend difficile — voire impossible — d’établir clairement combien de voyageurs ont réellement accompli ce qu’ils ont publiquement annoncé. En plus des attestations partielles ou incomplètes, il existe également des cas qui ont laissé encore moins de traces, difficiles à retrouver, voire aucune.
Dans ces conditions, un travail réellement exhaustif est évidemment irréalisable. Un recensement partiel des informations disponibles permet toutefois d’apprécier un phénomène encore peu connu et rarement étudié. Pourquoi s’intéresser aux micro-histoires de personnages éphémères et les réunir dans un Répertoire ? Les aventures des globetrotters nous racontent autrement la naissance d’un nouveau monde, dans lequel le voyage prend de nouvelles significations. Leurs actions permettent de mieux comprendre les origines de ces nouvelles dynamiques, et peut-être d’entrevoir les motivations qui sous-tendent ces pratiques sociales. Le voyage y prend une double valeur : un déplacement dans l’espace, mais aussi une traversée dans le temps, qui permet de lire les changements sociaux à travers le regard de femmes et d’hommes qui les ont vécus en première ligne.
Ce travail se veut un hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont aventurés sur des routes inconnues, souvent avec des moyens rudimentaires, suscitant fascination et émerveillement — des sentiments qui, aujourd’hui encore, demeurent intacts. Un hommage dû de la part de celles et ceux qui peuvent désormais voyager confortablement, en s’appuyant sur un réseau de services et de moyens de transport rapides et efficaces.
Le Répertoire est un document incomplet — un chantier ouvert auquel chacun est invité à contribuer, en signalant de nouveaux globetrotters ou en fournissant des détails et corrections sur ceux déjà répertoriés. Le premier chapitre propose des éléments de contextualisation du Répertoire. Le chapitre suivant présente les globetrotters dans l’ordre alphabétique : chaque fiche contient des informations essentielles, un bref résumé et les références utiles pour approfondir. Enfin, le texte accorde une place aux personnages imaginaires qui ont joué — et jouent encore — un rôle essentiel dans la promotion des nouvelles formes de consommation touristique.
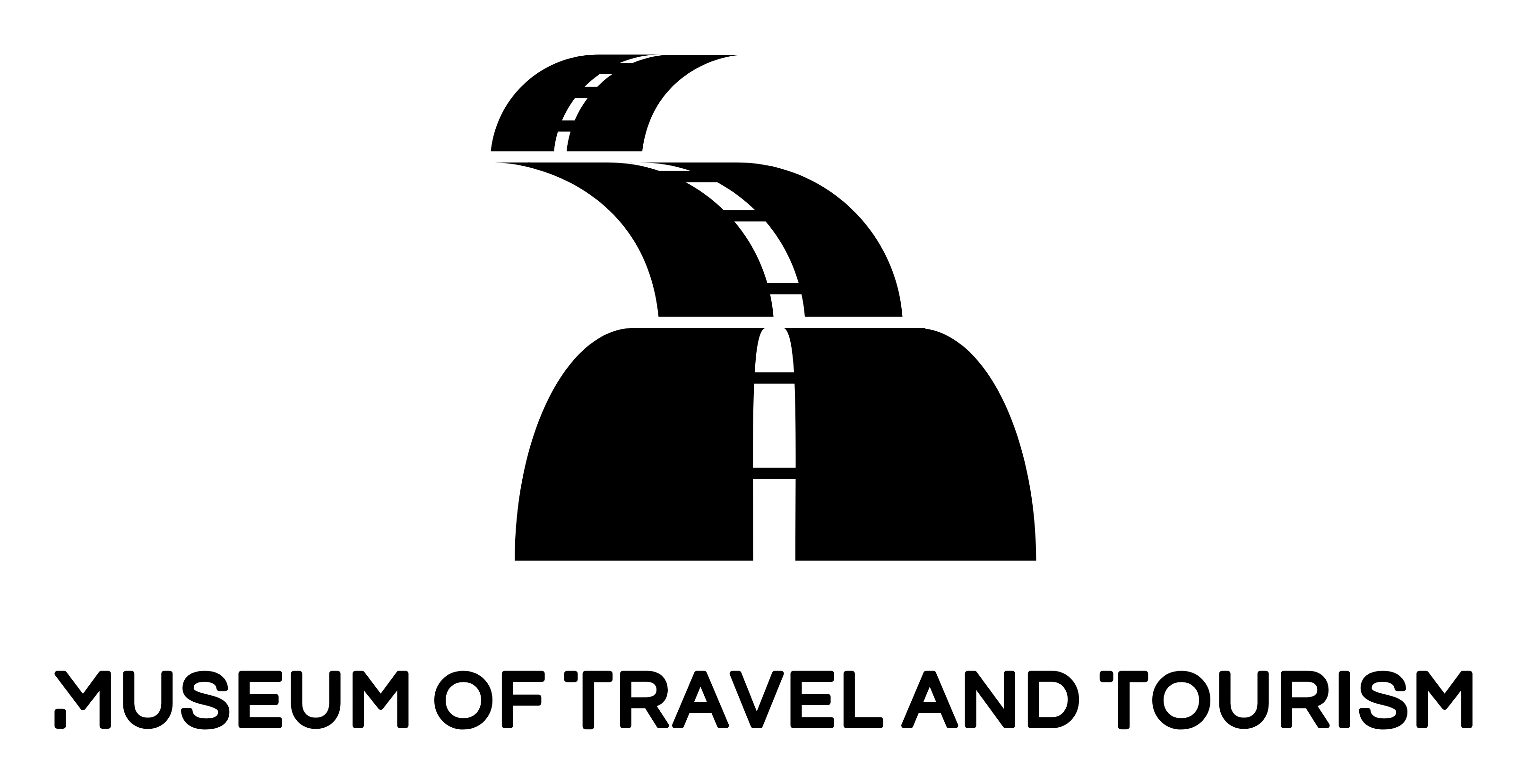
 IT
IT  FR
FR  DE
DE  EN
EN